BERNE ÉTUDIE LES EFFETS D’UNE RÉGULATION DU CANNABIS
La régulation du marché du cannabis n’est qu’une question de temps en Suisse. À Berne, une étude sur les effets sanitaires et sociaux d’une distribution contrôlée de cannabis devrait démarrer à l’automne.
 Cela fait longtemps que la réglementation de la vente de cannabis fait l’objet de discussions en Suisse. Classé comme stupéfiant, le cannabis contenant plus de 1% de Tetrahydrocannabinol (THC), est interdit dans notre pays. Néanmoins, beaucoup en consomment à des fins récréatives, ce qui a pour effet de créer un marché noir, avec tous les effets négatifs que cela peut impliquer. En 2021, la modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) a marqué un tournant en permettant la réalisation d’essais pilotes sur une distribution contrôlée de cannabis. À la suite de quoi, des chercheuses et chercheurs de l’Université de Berne ont décidé de relancer l’étude prévue en 2017, qui n’avait pas pu être conduite à l’époque, faute de cadre réglementaire le permettant. L’étude vise à examiner scientifiquement les effets sanitaires et sociaux de la vente réglementée de cannabis en pharmacie.
Cela fait longtemps que la réglementation de la vente de cannabis fait l’objet de discussions en Suisse. Classé comme stupéfiant, le cannabis contenant plus de 1% de Tetrahydrocannabinol (THC), est interdit dans notre pays. Néanmoins, beaucoup en consomment à des fins récréatives, ce qui a pour effet de créer un marché noir, avec tous les effets négatifs que cela peut impliquer. En 2021, la modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) a marqué un tournant en permettant la réalisation d’essais pilotes sur une distribution contrôlée de cannabis. À la suite de quoi, des chercheuses et chercheurs de l’Université de Berne ont décidé de relancer l’étude prévue en 2017, qui n’avait pas pu être conduite à l’époque, faute de cadre réglementaire le permettant. L’étude vise à examiner scientifiquement les effets sanitaires et sociaux de la vente réglementée de cannabis en pharmacie.
Approuvée en mai dernier par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et financée par le Fonds national suisse (FNS), l’étude SCRIPT devrait donc démarrer à l’automne, non seulement à Berne, mais aussi à Bienne et à Lucerne. Ses résultats devraient contribuer à la base de discussion pour une future réglementation du cannabis.
Participer plutôt que de laisser faire
La régulation de la «beuh» n’est en effet probablement qu’une question de temps, et les gens doivent s’y préparer. «Les autorités veulent réguler? Très bien. Le but de notre étude est de faire une proposition de régulation stricte est d’en étudier les effets.», explique Reto Auer, médecin de famille et coordinateur de l’étude SCRIPT à l’Université de Berne, qui propose que les professionnel(le)s de santé publique, les autorités sanitaires et la communauté participent au débat et de ne pas laisser l’industrie bourgeonnante du cannabis définir seule le cadre réglementaire.
«En tant que chercheurs, nous n’avons pas à être pour ou contre une régulation. Ce n’est pas notre rôle. C’est au politique de décider comment réguler le cannabis à l’avenir. Nous espérons que les résultats de l’étude pourront contribuer aux débats. La Commission Fédérale des Questions liées aux Addictions (CFANT) recommande que le cannabis soit accessible, mais pas promu. Il s’agit d’éviter d’ouvrir les vannes du jour au lendemain, comme au Colorado, où des enfants ont fini à l’hôpital car ils avaient avalé accidentellement des bonbons au cannabis peu sécurisés. Il ne faut pas non plus encourager la vente et la consommation avec de la publicité. La CFANT ne recommande pas que le cannabis soit vendu en grandes surfaces. En gros, il s’agit de ne pas faire la même erreur qu’avec le tabac et l’alcool», poursuit Reto Auer. C’est pourquoi l’étude sera réalisée selon un «modèle à but non-lucratif», c’est-à-dire sans générer de profit pour les points de vente, avec interdiction stricte de publicité, formation du personnel et le cannabis vendu dans des «paquets neutres».
Le choix des produits en pharmacie
Concrètement, le plan est de recruter 1091 participant(e)s dans les trois villes sélectionnées, dont environ 700 à Berne. Les personnes participant à l'étude seront des personnes qui consomment régulièrement du cannabis, âgé(e)s d’au moins 18 ans. La moitié d’entre elles pourra continuer d’acheter du cannabis sur le marché noir, tandis que l’autre moitié pourra acheter des produits fabriqués spécifiquement pour l'étude dans des pharmacies sélectionnées, et dont la concentration en THC sera limitée à 20% au maximum.
«Ils auront le choix entre des fleurs de cannabis, des résines de cannabis, du cannabis à vapoter et des teinture de cannabis à usage oral», détaille Reto Auer. Les prix de vente tiendront compte de la teneur en substance active, des prix pratiqués sur le marché illicite, et couvriront les frais des pharmacies, sans générer de profits pour les pharmacies.
Faire d’une pierre deux coups
L’étude SCRIPT vise à évaluer les conséquences de la vente réglementée de cannabis sur le comportement de consommation et la santé des fumeurs de joints. Elle vise en particulier à encourager le changement de consommation de formes fumées de cannabis et tabac vers des formes à risque réduit. «La grande majorité des personnes qui consomment du cannabis le fument et fument également des cigarettes de tabac. Le personnel de pharmacie pourra conseiller et informer les personnes participant à l’étude sur d’autres formes de consommation de cannabis et de nicotine moins nocives pour la santé, comme par exemple la vaporisation, le vapotage de cannabis ou les formes orales de cannabis tout comme les formes alternatives de consommer la nicotine», indique Reto Auer. «On espère ainsi que 10 à 20% des personnes participant à l’étude change de méthode.»
Pour la collecte des données, les personnes participant à l’étude devront se rendre au centre d’étude lors du lancement du projet, puis six mois plus tard. Ensuite, elles seront invitées à répondre à un questionnaire par téléphone ou par mail tous les six mois. L’étude SCRIPT durera au maximum deux ans.
Christine Werlé, août 2023
BERNE, UNE VILLE AUX ACCENTS MUSICAUX
 Amoureuse de l’allemand et musicienne, la Genevoise Loreen Häsler s’est retrouvée sur les bords de l’Aar après un parcours atypique, mais surtout éclectique, inspiré par les études, l’envie de retrouver ses origines asiatiques (sa mère est cambodgienne) et le fort désir de faire de la musique : Bâle, Zurich, Vienne, le Cambodge, Baden, Berthoud et dernièrement la Grèce, avant de venir accrocher ses pénates à Berne pour une partie de la semaine. C’est lors de la période de confinement, il y a deux ans, qu’elle a commencé à jouer de la contrebasse dans les rues de la Cité des Ours, où de belles rencontres et des amitiés ont débouché sur un premier album musical du groupe fraîchement constitué « Chloe et Les Vaillantes ».
Amoureuse de l’allemand et musicienne, la Genevoise Loreen Häsler s’est retrouvée sur les bords de l’Aar après un parcours atypique, mais surtout éclectique, inspiré par les études, l’envie de retrouver ses origines asiatiques (sa mère est cambodgienne) et le fort désir de faire de la musique : Bâle, Zurich, Vienne, le Cambodge, Baden, Berthoud et dernièrement la Grèce, avant de venir accrocher ses pénates à Berne pour une partie de la semaine. C’est lors de la période de confinement, il y a deux ans, qu’elle a commencé à jouer de la contrebasse dans les rues de la Cité des Ours, où de belles rencontres et des amitiés ont débouché sur un premier album musical du groupe fraîchement constitué « Chloe et Les Vaillantes ».
Qu’est-ce qui vous plaît à Berne et pourquoi y avoir élu domicile ?
Par sa position géographique et sa rivière, Berne m’a toujours plu. L’un de mes premiers contacts s’est fait pendant le confinement, alors que je jouais de la contrebasse dans les rues (désertes) et que j’habitais à Berthoud. Je pense que c’est grâce aux rencontres que j’ai faites qu’un lien particulier s’est tissé avec la population bernoise. Jouer dans les rues, c’est un peu se mettre à nu et tenter d’accrocher les passants sans savoir si notre musique leur plaît ou pas. Et quand ils s’arrêtent, cela débouche sur le partage d’un moment particulier, une sorte de complicité. Comme les répétitions avec notre groupe Chloé et les Vaillantes se font ici, je partage pour l’heure mon temps entre Berne et Genève, car j’ai aussi besoin de garder le contact avec ma famille.
Quels sont les lieux de Berne qui vous interpellent particulièrement ?
Berme a plusieurs facettes qui m’ont toujours plu, comme sa position géographique ou encore cette « presqu’île » du centre historique, enserrée par les méandres de l’Aar et sa couleur parfois émeraude. De manière plus détaillée, autant la communauté d’Anstadt (ndlr : près du Gaskesselwerk) que les arcades sont des aspects contrastés de Berne qui me parlent et me plaisent. J’ai l’impression que la façon dont Berne est construite reflète le côté tranquille de ses habitantes et ses habitants. Quand je suis à Berne, j’ai l’impression d’être invitée à être en paix. De plus, on y parle le « Bärndütsch », la langue que mon grand-père parlait (sourire gêné).
Berne est une ville un peu contrastée, avec des endroits très habités et d’autres, très verts et plus calmes. Y a-t-il un endroit particulier où vous vous rendez volontiers ?
Vu que je pratique également de la danse avec du feu, il y a un endroit que j’affectionne particulièrement pour m’entraîner en été, c’est le Dalmaziwiese (ndlr : à côté du Marzilibrücke), là où les gens font du slackline et du yoga. En hiver, on a la chance d’avoir la salle de gymnastique d’Altenberg qui est mise deux fois par semaine à la disposition des artistes et des gens qui pratiquent ce genre d’activités.
Si vous deviez quitter Berne, que prendriez-vous dans vos bagages ?
L’Aar et tous les chemins qui la bordent et les escaliers qui y mènent depuis la vieille ville. Et il y a une chose que je n’ai pas encore faite et que je me réjouis de faire cet été, c’est la descente de l’Aar en bateau gonflable. Je n’aimerais pas quitter la ville avant d’avoir pu pratiquer cette tradition typiquement bernoise (Rires).
Les coups de cœur de Loreen Häsler :
- Le Rosengarten et les succulents tiramisus du restaurant éponyme
- Le Lentulus-Hubel pour les couchers de soleil
- Le public bernois, chaleureux et respectueux des artistes
- Le Mahogany (là où a eu lieu le vernissage de l'album Footsteps de Cloe et les Vaillantes
Pour écouter l’album Footsteps, rendez-vous sur Chloe et Les Vaillantes ou l’émission de Carnotzet Voltaire de Radio Bern RaBe dans laquelle deux des protagonistes ont été reçues par Laure Thorens : Folk éclectique – Chloe et Les Vaillantes – Radio Bern RaBe
Propos recueillis par Nicolas Steinmann, avril 2023
FINIR SA VIE EN SUISSE-ALLEMAND
Peut-on vieillir à Berne en tant que francophone? La question se pose inévitablement à celles et ceux qui ont atteint l’âge de la retraite. La ville fédérale ne propose en effet aucun EMS bilingue.
 Il y a encore une vingtaine d’années, vieillir à Berne posait un insurmontable problème aux Romands et francophones habitant en ville et dans les environs, car il n’existe aucun établissement médico-social (EMS) proposant des services en français. «Je sais qu'une institution de la ville de Berne a depuis des années sa propre unité pour des résidents italophones. Mais je ne connais pas d'équivalent en français», confirme Sevan Nalbandian, directeur de Curaviva BE, l’association des EMS du canton de Berne. Combien de personnes de langue française ont quitté Berne pour cette raison, une fois l’âge de la retraite atteint? On l’ignore, la langue maternelle n'étant pas enregistrée par le service des habitants.
Il y a encore une vingtaine d’années, vieillir à Berne posait un insurmontable problème aux Romands et francophones habitant en ville et dans les environs, car il n’existe aucun établissement médico-social (EMS) proposant des services en français. «Je sais qu'une institution de la ville de Berne a depuis des années sa propre unité pour des résidents italophones. Mais je ne connais pas d'équivalent en français», confirme Sevan Nalbandian, directeur de Curaviva BE, l’association des EMS du canton de Berne. Combien de personnes de langue française ont quitté Berne pour cette raison, une fois l’âge de la retraite atteint? On l’ignore, la langue maternelle n'étant pas enregistrée par le service des habitants.
«La ville de Berne a réalisé un sondage il y a 14 ou 15 ans pour savoir s’il y avait un intérêt de la part des Romands à la création d’une maison de retraite bilingue. Mais l’enquête n’a pas été concluante. La mise en œuvre ne s’est jamais faite car les personnes âgées voulaient rester dans leur quartier. C’était trop compliqué à réaliser», se remémore Maria Gafner, ancienne diacre à l’Église française de Berne.
Toujours pas d’offre en français
Aujourd’hui, les choses n’ont guère changé du côté de l’offre linguistique dans les EMS bernois. «Il n'y a pas de maisons de repos bilingues en ville de Berne et il n'est pas prévu de le faire», souligne Katrin Haltmeier, cheffe de projet au Centre de compétences vieillesse de la ville de Berne.
Il faut aussi savoir que les autorités cantonales n'imposent pas d'exigences aux maisons de retraite concernant les compétences linguistiques de leur personnel. «La planification des établissements médico-sociaux dans le canton de Berne vise à ce qu'il y ait à peu près le même nombre de places en maison de repos disponibles pour chaque personne de plus de 80 ans dans la région respective. Cela garantit que les personnes francophones ou bilingues peuvent également trouver des places appropriées en maison de retraite», assure Gundekar Giebel, chef de la communication à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne.
L’évolution des mentalités
Pour Sevan Nalbandian, la langue en règle générale ne constitue pas un obstacle à l'entrée dans une institution bernoise de son choix. «Sans pouvoir me référer à des statistiques correspondantes, je pars du principe que la plupart des EMS de la ville de Berne peuvent également accueillir sans problème des résidents francophones, d'autant plus que nombre de ces personnes sont au moins bilingues ou n'insistent pas exclusivement sur le français.»
Si l’offre linguistique dans les maisons de retraite n’a pas été développée, les mentalités, elles, ont effectivement évolué. «J’ai moins rencontré le problème de la langue ces dernières années, car les seniors sont désormais bilingues. Ils arrivent à se faire comprendre», constate Maria Gafner, ajoutant: «Nos aînés ont dû faire des efforts, car pas mal de médecins à Berne viennent d’Allemagne, donc ils ne comprennent pas le français.»
Rester proche de sa famille
Ainsi, nombreux sont aujourd’hui les francophones qui ont choisi de couler leurs vieux jours dans la ville fédérale. «Les Romandes et Romands que je connais ont choisi de rester à Berne, témoigne Yves Seydoux, ancien journaliste et porte-parole. Mes parents, aujourd'hui décédés, sont restés ici. Les quelques vivants de leur génération ont fait de même, ayant passé toute leur vie à Berne et leurs enfants y habitant aussi. Je pense que, dans ce genre de choix, la proximité des proches est déterminante.»
Michel Schwob, ancien vice-chancelier à la Chancellerie cantonale bernoise, abonde dans le même sens: «Je vis toujours à Zollikofen, que je quitterai peut-être un jour pour un EMS, mais ce sera à Berne ou dans la région.» Il regrette que le critère de la langue soit déterminant pour certains. Lui personnellement préfère miser sur la qualité des soins plutôt que sur l’offre linguistique. «Il y a de toute façon des Romands dans toutes les maisons de retraite de Berne et des environs. Rien qu’à Zollikofen, j’en connais deux ou trois. Si je retournais aujourd’hui à Fribourg, je ne connaîtrais plus personne!».
«Ne pas mourir en suisse-allemand»
Tous les Romands et francophones de Berne ne partagent toutefois pas cet avis. «Après vingt-trois ans passés à Berne comme rédactrice au Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), je suis rentrée en 2011 dans le canton de Vaud, pour être près de ma famille et ne pas mourir en suisse-allemand», raconte Lucienne Hubler. «Je regrette certains agréments de la vie à Berne, les facilités de promenades dans les environs, la saison musicale et théâtrale, mais suis contente de mon choix, même si les rencontres se raréfient avec mes amis bernois.»
Sarah Vollert, diacre à l’Église française de Berne, a elle aussi rencontré une certaine insatisfaction parmi des aînés de langue française: «Je connais deux seniors, deux hommes, qui m’ont confié se sentir isolés dans l’EMS où ils se trouvent à cause du suisse-allemand.»
Christine Werlé, mars 2023
COLLÉGIALE OU CATHÉDRALE?
 Depuis plus de quarante ans, une polémique anime les discussions de la communauté francophone de Berne : le Münster est-il une collégiale ou une cathédrale ? Comme aucune décision officielle n’a été rendue, la question n’a jamais été résolue. Et s’il s’agissait en fait d’une abbaye ?
Depuis plus de quarante ans, une polémique anime les discussions de la communauté francophone de Berne : le Münster est-il une collégiale ou une cathédrale ? Comme aucune décision officielle n’a été rendue, la question n’a jamais été résolue. Et s’il s’agissait en fait d’une abbaye ?
La controverse a éclaté au début des années 1980, si l’on en croit les archives du Courrier de Berne : comment traduire en français le mot «Münster»? Par « collégiale » ou par « cathédrale » ? Aucune décision officielle n’ayant été prise jusqu’ici, les deux traductions sont utilisées. Lassé par la correspondance de lecteurs qui proposaient à tour de rôle soit « collégiale », soit « cathédrale », feu le rédacteur en chef Ernest Wüthrich avait finalement opté pour « collégiale » dans les articles de notre mensuel. Mais, en 1992, une étude de Berchtold Weber, destinée à la Bourgeoisie de Berne, est arrivée à la conclusion qu’il fallait dorénavant utiliser le mot « cathédrale ».
Pour étayer sa thèse, ce professeur de mathématiques et d’informatique féru d’histoire, s’appuie sur plusieurs arguments : le premier est que les dictionnaires Larousse, Langenscheidt et Mozin traduisent «Münster» par « cathédrale ». Ensuite, même si, d’après le droit canon, le mot « cathédrale » ne s’applique qu’à un évêché, le Münster n’a pas à se conformer aux prescriptions catholiques, n’étant pas concerné. Autre argument : le mot « collégiale » appliqué à l’Église évangélique réformée est une référence à l’histoire et ne rend pas compte de son état actuel : un temple. Jusqu’en 1485, le Münster est une église paroissiale consacrée à saint Vincent de Saragosse, dont le service est assuré par l’Ordre Teutonique (Deutsche Orden).
L’équivalent d’une ville épiscopale
Le 19 octobre 1484, le pape charge l’évêque de Lausanne de détacher cette paroisse de l’Ordre Teutonique et d’en faire une collégiale laïque, ce qu’elle demeure jusqu’à la Réforme en 1528. En 1485, les chanoines de saint Vincent succèdent aux chevaliers teutoniques et établissent un monastère au Münster. Comme Berne se trouvait sur la rive gauche de l'Aar sur le territoire de l'ancien diocèse de Lausanne (la rive droite de l'Aar appartenait alors au diocèse de Constance), la liturgie du diocèse de Lausanne fut introduite.
Bien que n’abritant aucun évêque, la ville de Berne possédait les mêmes avantages qu’une ville épiscopale, le responsable de la collégiale ayant reçu les ornements pontificaux, selon Berchtold Weber. De plus, on employait déjà le mot «Münster» (qui vient du latin « monastérien » qui signifie monastère) pour désigner l’église. Après la Réforme, le doyen du Münster occupait les mêmes fonctions qu’un évêque : charges d’instituteur, consécration des pasteurs et présidence du Tribunal de la Cour suprême ecclésiastique. Berne n’a pas placé un évêque à la tête de l’Église nationale, comme le conseillait Luther. Pourtant, le pouvoir du doyen du Münster était très étendu, le Münster étant l’église principale de la Suisse réformée.
La décision du propriétaire
Après les négociations avec la Cour de France concernant les guerres de Bourgogne (1474 à 1477), Berne s’est mise au français, rappelle encore Berchtold Weber dans son étude. La traduction du mot «Berner Münster» est donc une question ancienne. Une traduction actuelle doit se mesurer à celle qui avait été proposée à cette époque. L’architecte Carl von Sinner publia en 1790 un plan de la ville de Berne dans lequel il désignait la «Grosse Kirche» ou bien «Münster» par l’expression « Église cathédrale Saint-Vincent ». On croit qu’il a suivi en cela l’usage de cette époque, voulant seulement rendre compte des noms des rues et des bâtiments qui existaient déjà et non pour faire un nouveau plan. De nombreuses preuves attestent qu’au XIXe, le Münster était appelé « cathédrale ». Au cours des années 1860, la Municipalité a fixé l’usage en traduisant «Münsterplatz» et «Kirchgasse» (la Münstergasse depuis 1967) par « Place de la cathédrale » et « rue de la cathédrale ».
Vers 1880, l’intérêt porté à l’histoire de l’art se développe. Voulant se référer à l’usage catholique selon lequel une église réformée doit prendre le nom qu’elle portait avant la Réforme, on a traduit «Münster» par « collégiale ».
Enfin, toujours selon Berchtold Weber, seul, le propriétaire du bâtiment est en droit de déterminer quelle sera la traduction définitive. Le Conseil paroissial du Münster a confirmé en 1993 vouloir conserver le mot « cathédrale » dans la traduction de «Berner Münster». Sa position est motivée par les arguments suivants : le Conseil suit l’usage de la langue du XVIIIe siècle ; le mot « cathédrale » est la traduction littérale de «Münster» ; Berne a eu un prévôt capitulaire exerçant tous les pouvoirs épiscopaux; le doyen qui travaillait à l’église de Berne avait toutes les fonctions d’un évêque.
Un terme trompeur
Bernd Nicolai, professeur émérite à l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Berne, n’est pas de cet avis. « Le Münster de Berne était à la fois une église collégiale (Stiftskirche) et une église paroissiale, retrace-t-il. «Münster» est un terme historique utilisé en général pour les églises du sud de l'Allemagne, en Alsace et en Suisse alémanique, c'est-à-dire dans l’espace germanophone. Il vient du latin « monasterium » (monastère), mais fait référence aux églises de ville, qu'il s'agisse de cathédrales, d'églises paroissiales ou collégiales (Berner, Baseler, Strasbourg, Freiburger Münster). »
Pour le spécialiste, le terme « cathédrale » est assez trompeur car Berne n'a jamais été le siège d'un évêque. « Le Münster de Berne était sous la responsabilité de l'évêque de Lausanne. Dans cet esprit, nous avons également utilisé le terme « collégiale » dans la version française du nouveau guide de la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS). L'Aar formait également une frontière entre les évêchés de Lausanne et de Constance. »
Une nouvelle définition
Felix Gerber, sacristain et responsable du Münster, propose une variante. En préambule, il rappelle que lors de la fondation de Berne vers 1190, la ville appartenait ecclésiastiquement à la paroisse de Köniz, une commanderie de l'Ordre Teutonique. En 1276, Berne devint une commanderie de l'Ordre Teutonique. Ce dernier nommait le curé de la ville à l'église de la ville, dédiée à saint Vincent, et réglait le service selon la liturgie de l'ordre.
« Étant donné que le Münster de Berne n'a jamais été le siège d'un évêque, c'est-à-dire jamais une cathédrale (terme utilisé dans les régions de langue latine) ou un dôme (terme utilisé dans les régions de langue allemande), mais appartenait à l'Église de Köniz et donc à l'Ordre Teutonique avec sa structure de type monastère jusqu'au XVe siècle, le terme «Klosterkirche» (église du monastère ou abbaye) n’est pas tout à fait faux », étaie Felix Gerber.
Christine Werlé, janvier 2023
Parole à Pascal Vandenberghe, président-directeur général de Payot SA
PAROLE
Payot revient à Berne après 25 ans d’absence. La librairie romande s’installera au 3e étage de Stauffacher dès la mi-octobre. Pascal Vandenberghe, président-directeur général de Payot SA, explique ce qui a motivé son retour dans la ville des bords de l’Aar.
 «JE NE VOULAIS PAS REVENIR SEUL À BERNE»
«JE NE VOULAIS PAS REVENIR SEUL À BERNE»
Payot a quitté Berne en 1997. Qu’est-ce qui a motivé ce retour dans la ville fédérale?
Plusieurs choses: d’abord, une enseigne comme Payot se devait d’être présente dans la capitale, où existe une communauté francophone. Elle n’est pas uniquement composée de résidents, mais aussi de politiciens et de pendulaires. Après, c’est une question d’opportunité. Je ne voulais pas revenir seul, en raison des loyers exorbitants en ville et des coûts d’investissement. L’objectif était donc de réduire les coûts. Il se trouve qu’en 2019, nous avons repris les locaux de la librairie ZAP à Sierre (VS), qui fait partie d’une chaîne appartenant à Orell Füssli. À cette occasion, j’ai rencontré Pascal Schneebeli, président-directeur général et membre du conseil d’administration d’Orell Füssli Thalia AG. Je lui ai proposé le concept d’une librairie dans une librairie, et il a tout de suite été emballé. Mais nous avons dû reporter le projet en raison de la pandémie de Covid-19.
Une librairie dans une librairie, c’est plutôt original comme concept… C’est unique en Suisse?
À ma connaissance, oui. Nous allons louer la surface d’environ 235 m2 au troisième étage de la librairie Stauffacher à la Neuengasse 37. Ce qui correspond à la taille d’une librairie moyenne telle que celle de La Chaux-de-Fonds. Nous nous chargerons des travaux et nous aménagerons avec des meubles Payot.
Estimez-vous qu’il y a une vraie demande livres en français à Berne? Qu’est-ce qui a changé par rapport à l’époque de votre départ il y a 25 ans?
J’espère en tout cas! C’est une clientèle potentielle non négligeable. Plusieurs raisons ont motivé le départ de Payot de Berne en 1997: d’abord, la clientèle faisait défaut à cause de l’emplacement de la librairie qui n’était pas idéal (ndlr : à la Bundesgasse 16). Ensuite, Payot devait à cette époque se concentrer sur la rénovation de ses librairies en Suisse romande. Enfin, on arrivait à la fin du bail et, pour les raisons citées ci-dessus, il a été plus simple de ne pas le renouveler.
L’offre que vous proposerez à Stauffacher sera-t-elle aussi étoffée que celle de vos librairies en Suisse romande?
De taille comparable évidemment. Tous les secteurs d’une librairie Payot seront présents. La seule différence, ce sera l’offre en anglais que nous n’aurons pas, puisque Stauffacher dispose d’un tel rayon.
La fermeture en 2004 de La Nouvelle librairie française, qui avait repris le flambeau après votre départ, avait suscité beaucoup d’émoi dans la communauté francophone de Berne. Mais aujourd’hui, avec l’accélération de la numérisation de la société, est-il encore indispensable d’avoir une librairie physique?
Oui! Dans une librairie physique, le rapport au livre n’est pas le même. En ligne, on n’aura aucun effet de surprise, il faut savoir ce que l’on cherche. Il y a certains livres aussi, comme les livres d’art, que l’on préférera toujours toucher. Et puis, le rapport au client est différent: un libraire pourra donner des conseils et des recommandations. Les algorithmes ne remplacent pas les êtres humains.
Christine Werlé, août 2022
UN SIÈCLE DE COURRIER DE BERNE
1922-1930: NAISSANCE D’UN JOURNAL
Le premier Bulletin romand paraît le 1er novembre 1922, et se décrit comme l’organe officiel de l’Association romande de Berne, créée elle en 1879 par Eugène Borel et Elie Ducommun. Dans une introduction qui n’est pas signée, l’organe officiel de l’Association romande de Berne se présente à ses sociétaires et lecteurs en commençant par s’excuser de son apparence modeste… avant d’annoncer son objectif: jouer un rôle utile comme nouveau lien entre les membres de l’Association et favoriser la cohésion entre les Romands de Berne, ou ce qu’on appelait alors la «Colonie romande de Berne». La Commission de rédaction était composée de journalistes anciens et actuels mais se voulait aussi ouverte aux communications des lecteurs. L’introduction se termine par ces vers du musicien, chansonnier et pédagogue suisse Jaques-Dalcroze :
Et chantons en chœur
Le pays romand,
De tout notre cœur
Et tout simplement!
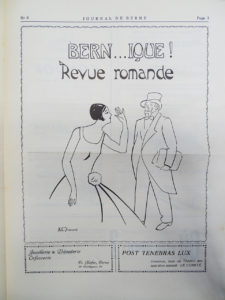 Une vie associative foisonnante
Une vie associative foisonnante
Après la Première Guerre mondiale, l’Association romande de Berne reprend la tradition – interrompue par le conflit – des grandes soirées annuelles, et le Bulletin romand lui sert avant tout d’agenda pour communiquer ces événements: conférences, soirées littéraires, arbre de Noël de l’Église française, réunions de sociétés, bals, thés dansants, excursion annuelle, Revue romande… La vie associative de l’époque semble foisonnante! Et il en sera de même jusqu’en 1930. On apprend notamment que les Romands de Berne avaient pour habitude de se réunir le soir du 1er Août au Bierhübeli et que les Genevois de Berne fêtaient l’Escalade dans la ville fédérale! Les événements organisés par les Tessinois et les Français de Berne sont parfois communiqués dans le journal. En outre, Le Bulletin romand publie également des avis mortuaires, des avis de naissance et d’innombrables publicités (voir photo).
L’apparition de thèmes de société
Des articles sur des thèmes de société voient peu à peu le jour: la question de l’opium, celle de l’école française, le bilinguisme, l’arrivée de la téléphonie automatique (1926), le cyclone qui a ravagé le Jura (1926)… Un article paru en 1924 fait état du recensement des minorités linguistiques à Berne. Ainsi, en 1910, le district de Berne comptait 4839 personnes de langue française, dont 4500 en ville. En 1920, on passe à 5797 personnes parlant français, dont 5396 en ville. En dix ans, la communauté francophone s’est accrue d’un millier de personnes, soit d’une centaine par année. Autre fait intéressant: en 1926, on apprend que les Romands revendiquent leur droit à un tiers des fonctions dans l’administration fédérale. À noter encore que les médias alémaniques de l’époque, tels que le Bund et Radio Berne, semble s’intéresser de près au petit journal romand, comme en attestent des articles sur le sujet. En 1929, Radio Berne consacre même un jour par semaine aux questions intéressant le Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg!
Transformations
Au cours de cette décennie, le journal des Romands de Berne change plusieurs fois de noms: de Bulletin romand, il devient le 6 mai 1925 Le Journal de Berne. 1930 semble être une année de grands changements, puisque la publication s’appelle brièvement la Gazette romande, avant de redevenir le Bulletin romand et de prendre un format beaucoup plus petit, et de passer de 8 pages à 4 pages. Ces transformations sont-elles dues aux difficultés financières que traversent le journal? Dès 1926, en tout cas, des appels à l’aide sont publiés. Ont-ils été entendus? Toujours est-il que le nombre d’abonnés passe de 700 en 1926 à 1200 en 1928. Et le nombre de numéros par année explose littéralement, passant d’une vingtaine à une… cinquantaine! Le tarif, lui, ne change pas: le numéro est toujours vendu au prix de 10 centimes.
Christine Werlé, février 2022
ASCENCEUR À POISSONS DE MÜHLEBERG
 Le groupe bernois BKW a mis en service un ascenseur à poissons à sa centrale hydraulique de Mühleberg. L’installation doit permettre aux poissons qui remontent l’Aar de franchir le barrage et de migrer vers le lac de Wohlen. Ce projet original est la première mesure que le fournisseur d’énergie met en œuvre dans le cadre de l’assainissement écologique de ses centrales hydrauliques, comme l’explique René Lenzin, porte-parole de BKW.
Le groupe bernois BKW a mis en service un ascenseur à poissons à sa centrale hydraulique de Mühleberg. L’installation doit permettre aux poissons qui remontent l’Aar de franchir le barrage et de migrer vers le lac de Wohlen. Ce projet original est la première mesure que le fournisseur d’énergie met en œuvre dans le cadre de l’assainissement écologique de ses centrales hydrauliques, comme l’explique René Lenzin, porte-parole de BKW.
«C’EST L’UNE DES PLUS GRANDES INSTALLATIONS DE CE TYPE EN EUROPE»
À quoi sert exactement cet ascenseur à poissons?
L’ascenseur de poissons doit garantir la libre migration des poissons. Il permet aux poissons de remonter l’Aar pour migrer vers le lac de Wohlen par-dessus le barrage haut de 20 mètres. À ce jour, les barrages sont souvent des obstacles insurmontables pour les poissons. L’ascenseur a été conçu pour permettre à un maximum d’espèces de poissons vivant dans l’Aar de migrer.
Comment fonctionne-t-il concrètement?
Au milieu de l’Aar, au niveau du môle de séparation et sur la rive gauche de l’Aar, se trouvent les passes d’accès pour les poissons. Les poissons trouvent leur chemin dans les passes grâce à un courant d’appel dans chaque passe. Les pompes assurent des conditions d’écoulement uniformes. Une fois au pied du puits de l’ascenseur, les poissons se retrouvent dans un bac rempli d’eau (cuve) qui se ferme automatiquement. Le bac est ensuite soulevé d’environ 20 mètres à l’aide d’un treuil. Arrivés en haut, les poissons sont automatiquement relâchés dans le lac de Wohlen à travers une gouttière. En raison de sa hauteur, l’ascenseur à poissons de la centrale hydraulique de Mühleberg est une des plus grandes installations de ce type en Europe.
Avez-vous déjà pu vérifier si les poissons empruntaient l'ascenseur?
Avant l'entrée en fonction de l’ascenseur de poissons, il y a eu une phase de test. Afin de vérifier si les poissons empruntent l’ascenseur, ils sont enregistrés statistiquement et observés avec des caméras lors de leur migration dans les canaux d’entrée et dans le bac. De cette façon, l’ascenseur peut être réglé de manière optimale et ajusté en permanence à la migration des poissons de l’espèce concernée.
Pour quelles raisons avez-vous décidé de mettre en place une telle installation?
La loi fédérale sur la protection des eaux révisée exige des exploitants de centrales hydrauliques qu’ils réalisent leur assainissement écologique d’ici 2030. L’ascenseur à poissons de Mühleberg est la première d’environ 40 mesures que BKW prévoit de mettre en œuvre dans le cadre de l’assainissement écologique de ses centrales hydrauliques.
Quelle somme avez-vous investi dans le projet?
6,2 millions de francs. La somme investie pour cet assainissement écologique est prise en charge par la Confédération.
Quelles autres mesures avez-vous prises dans le cadre de l'assainissement écologique de la centrale hydraulique de Mühleberg?
Actuellement, il n'y a pas d'autres mesures à Mühleberg. Mais au-delà de cette centrale et en plus des mesures d’assainissement écologique exigées par la loi fédérale sur la protection des eaux, BKW met en œuvre d’autres mesures pour que ses installations soient en harmonie avec la nature. Ces mesures supplémentaires sont en partie financées par le fonds écologique BKW.
Propos recueillis par Christine Werlé, décembre 2021
La nouvelle bataille de l'école cantonale de langue française de Berne (ECLF)
 Fondée en 1944 à l’initiative de la communauté romande, l’École cantonale de langue française de Berne (ECLF) a dû se battre pendant des décennies pour pouvoir exister. Ce n’est qu’à partir de sa cantonalisation en 1982 que l’école a enfin pu respirer. Mais son avenir s’annonce à nouveau chahuté avec la révision de la loi fédérale sur son subventionnement.
Fondée en 1944 à l’initiative de la communauté romande, l’École cantonale de langue française de Berne (ECLF) a dû se battre pendant des décennies pour pouvoir exister. Ce n’est qu’à partir de sa cantonalisation en 1982 que l’école a enfin pu respirer. Mais son avenir s’annonce à nouveau chahuté avec la révision de la loi fédérale sur son subventionnement.
Le Conseil fédéral entend réviser la loi fédérale concernant le subventionnement de l’École cantonale de langue française de Berne (ECLF). Il a ouvert en début d’année une consultation publique sur le projet de loi qui court jusqu’au 23 avril 2021. Ce sont des raisons d’adéquation aux dispositions du droit fédéral qui ont motivé sa décision. «La Confédération a constaté que la loi fédérale concernant l’allocation de subventions à l’ECLF de 1981 n’était plus conforme aux dispositions du droit fédéral et aux procédures actuelles en matière de subventions», explique Tiziana Fantini, responsable de projet communication au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). «De plus, la loi en vigueur se fonde sur un article constitutionnel qui n’existe plus. Une révision de la loi fédérale s’impose afin de remédier aux défauts constatés.»
L’ECLF est sous la responsabilité du canton de Berne, qui contribue aux coûts d’exploitation à hauteur de 75%, les 25% restant étant à charge de la Confédération. Ce soutien fédéral s’est monté à environ 1,3 million de francs en 2020. Il a pour but permettre aux enfants des employé(e)s non germanophones de l’administration fédérale et d’organisations dont l’existence sert la Confédération d’effectuer leur scolarité en français à Berne.
La Confédération assure que son soutien financier n’est pas remis en cause par la révision de la loi. «Le Conseil fédéral entend maintenir le niveau des aides financières de la Confédération à 25% des coûts d’exploitation de l’école», affirme Tiziana Fantini. «L’ECLF favorise le plurilinguisme, un aspect fondamental pour la Confédération.»
Une responsabilité commune mise en danger
Malgré ces garanties, le canton de Berne devrait s’opposer à la révision de la loi sous la forme proposée. «À l’origine, l’ECLF a été créée conjointement par la Confédération, le canton de Berne, la ville de Berne et la Société de l’École de Langue Française parce que les partenaires avaient un intérêt commun: concrétiser la cohésion nationale dans la capitale fédérale», explique Aldo Dalla Piazza, secrétaire général adjoint à la Direction de l’instruction publique du canton de Berne. «C’est dans ce sens que le canton a accepté de rendre cette école publique et cantonale. C’est pourquoi la responsabilité commune doit rester, selon nous. Or, avec la révision de la loi, la Confédération entend se désengager de cette responsabilité commune», affirme-t-il.
Subtil, le problème viendrait des termes techniques utilisés dans le projet de loi: on parle ici de «subvention» à une institution cantonale bernoise et non pas de «contribution» à une institution portée en commun. De plus, dans le texte, aucune référence n’est faite à la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (LLC). À terme, cela signifierait que la Confédération pourrait à tout moment modifier sa subvention et accroître son désengagement.
«La Confédération se retire en catimini, sans le dire, de manière implicite. Ce n’est pas fair-play», déplore Aldo Dalla Piazza. «On ne sait pas si c’est intentionnel ou si c’est seulement maladroit.»
Un ovni dans le paysage scolaire
Le directeur de l’ECLF, Michel Clémençon, partage cet avis: «L’ECLF fonctionne bien ainsi. Si la révision de la loi est acceptée, le canton pourrait être moins motivé à conserver l’école.»
L’ECLF, qui dispense un enseignement en langue française selon le plan d’études romand jusqu’au degré secondaire I, représente une exception dans le système scolaire. «C’est une école publique de langue française hors sol à Berne», tient à rappeler Michel Clémençon. Or, normalement, une école à Berne devrait dépendre de la commune et enseigner en allemand selon le plan d’études Lehrplan 21.
Des décennies de luttes
Si l’avenir de l’ECLF s’annonce mouvementé, son passé ne le fut pas moins. Fondée en 1944 sous l’impulsion du pasteur René Hemmeler et de membres de la communauté romande de Berne, réunis en une Société des Amis de l’École de Langue Française (SAELF, puis SELF), l’école dut se battre pour pouvoir exister. Sollicitées pour leur aide, les autorités firent longtemps la sourde oreille. «Les débuts étaient folkloriques!», se rappelle Simone Schweizer, institutrice à l’ECLF de 1950 à 1993. «Pour que l’on puisse nous lancer, les cantons romands nous ont prêté le matériel.»
 Installées à l’origine dans des appartements à la Schwarztorstrasse 5, les salles de classe étaient étroites, la cour de récréation pratiquement inexistante. «Ma salle de classe était si exiguë que je devais pousser mon bureau pour laisser les élèves entrer… Mais quelle époque formidable!», sourit Simone Schweizer. «Je me souviens que depuis mon pupitre, je ne voyais même pas toute la classe», renchérit Michel Clémençon.
Installées à l’origine dans des appartements à la Schwarztorstrasse 5, les salles de classe étaient étroites, la cour de récréation pratiquement inexistante. «Ma salle de classe était si exiguë que je devais pousser mon bureau pour laisser les élèves entrer… Mais quelle époque formidable!», sourit Simone Schweizer. «Je me souviens que depuis mon pupitre, je ne voyais même pas toute la classe», renchérit Michel Clémençon.
Pour que les fonctionnaires de la Confédération et du canton placent leurs enfants à l’ECLF, il fallut faire du porte-à-porte. Les écolages exigés n’empêchèrent pas de voir le nombre d’élèves augmenter. Au fil des ans, un jardin d’enfants fit son apparition, puis de nouvelles classes du degré secondaire. L’école suscita par ailleurs la grogne d’une partie de la population bernoise. «Un groupe de Bernois écrivaient régulièrement des tribunes dans les journaux. Ils voulaient nous détruire», s’emporte Simone Schweizer.
Les temps furent durs
Jusqu’à la cantonalisation de l’école en 1982, l’ECLF fut aux prises avec les pires difficultés financières. «Je me souviens d’un mois de décembre où l’on n’a pas pu être payé. On a tout de même reçu 250 francs pour acheter les cadeaux de Noël», poursuit Simone Schweizer. «Les institutrices et les instituteurs qui acceptaient de venir travailler à ces conditions n’avaient souvent même pas d’expérience professionnelle, mais tous défendaient l’école et étaient prêts à tous les sacrifices.»
Avec le temps, les interventions multiples des responsables de l’ECLF auprès des autorités finirent par porter leurs fruits. Certains appuis financiers, d’abord modérés, furent consentis. En 1962, le canton de Berne prit à sa charge le salaire des enseignants. Et en 1982, enfin, l’école devint publique et cantonale. En 1987, le canton vota un crédit pour la construction d’un nouveau bâtiment à Jupiterstrasse. L’inauguration eut lieu en avril 1991.
Les Français majoritaires
L’ECLF compte actuellement 340 élèves. Les Suisses constituent toujours la nationalité la plus représentée à l’école, juste devant les Français. «Les Sud-Américains scolarisent aussi systématiquement leurs enfants chez nous. De même que les Russes», note Michel Clémençon. 40,8% des écoliers sont issus de familles directement liées à la Confédération, aux ambassades et aux organisations internationales. Après l’ECLF, plus de la moitié des élèves vont faire une maturité à Bienne ou à Berne (bilingue).
Dossier préparé par Christine Werlé, avril 2021
